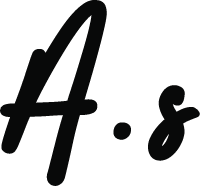La dystopie est annulée.
1969. Année 00
Le 27 juin 1969, le film Easy Rider de Donnis Hopper sort sur les écrans français. Il sortira trois semaines plus tard aux États-Unis.
Le 14 février 1970, David Mancuso organise sa première house party, nommée Love Saves The Day. Ils invitent des ami.e.s pour danser aux sons de la soul, du funk, du rock et de quelques autres disques plus expérimentaux.
Les analyses filmiques et culturelles de Easy Rider sont nombreuses. N’écrivant pas depuis une position académique, obligeant à une rigueur scientifique parfois sclérosante, j’enjambe volontiers un propos liminaire visant à présenter une synthèse exhaustive des nombreux travaux effectués sur cet artefact cinématographique. Je me contenterai d’une conclusion sur laquelle, j’imagine, nous pouvons toutes et tous nous retrouver. Easy Rider sonne la fin de la récréation. Easy Rider nous explique : jeunes femmes, jeunes hommes, la contre-culture des années 1960 est terminée.
Cette contre-culture née à l’endroit même où, dans les années 1970, se nicheront les fondations de la Silicon Valley, devenue, 70 ans plus tard, l’épicentre du capitalisme tardif et du basculement de ce système jusqu’alors confiné à un totalitarisme doux et volontairement inconscient, à un totalitarisme assumé et pleinement conscient.
En 1970, David Mancuso édifie, avec modestie et conviction, un dispositif portant une utopie sociale, culturelle et politique. Ce dispositif repose sur l’organisation de soirées musicales, sur un principe d’inclusion maximale de l’ensemble des communautés new-yorkaises, au premier titre desquelles les minorités sexuelles et racisées. Il y ajoute une exigence sans faille en matière de sélection musicale et de qualité de diffusion sonore, ainsi qu’un dernier élément, témoin et trace quasi hantologique de la contre-culture déjà morte, le LSD.
Depuis les États-Unis, première puissance mondiale célébrant en cette même année 1969, sa victoire technologique et civilisationnelle sur l’Union Soviétique en envoyant des hommes sur la Lune, deux perspectives culturelles et politiques s’ouvrent donc.
La première, la perspective Hopper, ouvre le temps de la dystopie, des futurs perdus, du déclin culturel et de la tout-puissance de ce que Mark Fisher, des décennies plus tard, nommera le réalisme capitaliste.
La seconde, la perspective Mancuso, ouvre un espace d’utopie tout aussi subversif que non énoncée. L’utopie de la fin de siècle et du début du prochain millénaire est simple. Elle se résume ainsi : ne perdons pas nos âmes, restons vivants.
2025. Nouvelle année 00
Je n’ai aucunement besoin de vous signifier laquelle de ces deux perspectives prendra l’avantage, lourdement, sur l’autre. La perspective Hopper n’aura de cesse de prendre de l’ampleur et de gagner du terrain. Elle engendra, contre-intuitivement, ce que la production culturelle offrira de plus stimulant et jouissif ces 70 dernières années : le Nouvel Hollywood, l’auto-production musicale, l’anticipation et les expérimentations artistiques… Cette perspective sera soutenue, par défaut et dans le même temps, par une production intellectuelle brillante, révolutionnaire et fulgurante (je me content ici, maladroitement, de circonscrire cette « production intellectuelle » à l’aire culturelle dite occidentale. Je m’excuse donc de cette occidentalocentriste culturel mais je n’ai pas le temps ni l’ambition ici-même de balayer l’ensemble de la production intellectuelle mondiale, aussi stimulante soit-elle).
En 1969 naît ainsi au cœur du bois de Vincennes le campus du même nom. Paris 8. En 10 ans, cette université, récusent les conventions académiques pour inventer un mode de production de pensée et de transmission des savoirs inédit (si ce n’est à l’ère pré-socratiques peut-être, pour ce qui est de la civilisation européenne). La French Theory, avec ses armes miraculeuses qui se nomment Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Barthes, Lyotard, vont générer une intensification sans précédent de la théorie critique. Ils révèlent le présent et le futur comme nuls autres.
Outre-manche, cette école de pensée prend la forme, depuis les années 1960, des études culturelles, édifiées à partir du Centre d4études Culturelles de Birmingham, qui « enfantera » de théoriciens critiques (et marxistes notamment) indispensables pour comprendre le monde dit réel à partir de la production culturelle de ce même monde. Je me contenterai pour cette école de Birmingham de citer deux noms : Stuart Hall et Paul Gilroy. Dans les années 1990, à l’université de Warwick, cette école de pensée est réactivés et intensifiée par le Cybernetic Culture Research Unit, dont Mark Fisher, précedemment cité, fut l’un des animateurs puis l’un des légataires les plus importants.
On sait, depuis ces travaux, ces œuvres et productions culturelles, que le futur s’annonce annulé.
De l’autre côté, David Mancuso développe sa soirée et l’utopie qui la porte. Pour une histoire détaillée et documentée de cette aventure, vous pouvez vous référer au livre Love Saves The Day, de l’historien Tim Lawrence, récemment traduit par les éditions Audimat. La perspective Mancuso constitue une constellation d’initiatives, d’expériences et de productions culturelles tout aussi fournies. On pense à la Borde. On pense tout autant à Vincennes, dans une perspective inversée et positiviste. On pense aux révolutions musicales qui n’ont eu de cesse jusqu’à la fin des années 1990 d’obliger à un déplacement quant à la qualité et la teneur de ce que la musique et le sonore peuvent charrier et produire en termes de récits du passé, du présent et du futur, le tout tenant, dans le cas du hip hop notamment, dans un même geste de composition par l’usage du sampling. Pourtant, cette perspective vivace et lumineuse ne fait pas le poids. Le futur, à l’orée des années 2000 par son corollaire, l’enclenchement de l’ère numérique et la (contre-)révolution anthropologique et culturelle dont on ne perçoit que maintenant l’impact réel, est bel et bien annulé.
Cette révolution trouve (peut-être) son achèvement aujourd’hui avec l’élection de Donald Trump. Le techno-capitalisme abat ses cartes et son ambition, déjà connue et étayée mais maintenant limpide pour le plus grand nombre, est comme écrite sur tous les écrans de smartphones du monde : nous allons vous manger.
Aujourd’hui. L’urgence de l’imaginaire utopique.
Avec la perspective Hopper et l’ensemble des productions culturelles qui lui sont associées, de près ou de loin, la dystopie que nous vivons aujourd’hui a été décrite dans ses moindres détails. 1984, Alien, Terminator, la science-fiction de Damasio, Under The Skin, les musiques jungle et techno…. la liste est trop longue. Elle est pléthorique et renseigne avec une exactitude aussi confondante que saisissante les actualités que vous lirez ce matin dans votre journal ou sur internet.
Alors, voilà, nous avons tout dit, tout écrit, tout filmé, tout composé depuis 1969 jusqu’à 2025 sur la fin d’un monde qui se déroule, dans la réalité la plus crue et cruelle, devant nos yeux aujourd’hui. Je rappelle que j’écris depuis une position non académique, libéré ainsi des exigences d’exhaustivité de l’écriture universitaire et scientifique. Il n’y aura dans ce texte aucun « mais », aucune pondération, aucun équilibre neutralisant la petite idée que je tente de déployer par la forme non aboutie de mon écriture. La pondération, l’équilibre, la justesse d’analyse constituent des exigences inhérentes à l’exercice intellectuel. Seulement voilà, je n’en passerai pas (plus?) par cette pondération, cet équilibre, cette justesse chimérique, parce que j’aspire à me déplacer dans un nouvel espace d’imaginaires et d’utopies qui nécessitent une intensification à la mesure de l’intensification du capitalisme tardif. Je souhaite mener ma modeste guérilla. Je prends les armes et je ne peux, en conséquence, peser aujourd’hui et maintenant les limites de cette entreprise. Je dois m’y noyer comme on se noie lorsque l’alcool nous enivre ou l’herbe nous satellise. Je dois me perdre pour mieux me retrouver. Je saute dans l’inconnu, non sans crainte mais avec joie, espoir et une pleine et entière conviction. Je me déplace vers un territoire que je crains, celui de la foi. La foi en nous.
Le capitalisme entre (peut-être) dans son dernier cycle. Il sera douloureux et peut-être définitif. Nous ne survivrons peut-être pas à sa chute. Les chances sont nombreuses qu’il nous engloutisse.
Pourtant, chose incroyable, chose essentielle, chose aussi surprenante qu’impossible à considérer en son sein, tellement ses désirs nous ont envahis, nous amenant à muter, depuis 1969, en une espèce mi-alien, mi-zombie. Des humains dépossédés ou trop possédés, schizos, dépressifs, burn-out-é•e•s. Moi-même, être humain né en 1981, sous l’ère du capitalisme bientôt déjà triomphant et bientôt sur-puissant, touché depuis trop d’années par une forme de psychopathologie symptomatique de ce système car épousant les mêmes cycles que ce dernier, la bipolarité.
LE CAPITALISME PRENDRA FIN ET CE NE SERA PAS LA FIN DE L’HISTOIRE.
LE CAPITALISME PRENDRA FIN, DEMAIN, ou APRES-DEMAIN ET L’HISTOIRE CONTINUERA.
C’est à cette nouvelle histoire future que je souhaite m’atteler dés aujourd’hui. C’est ce futur de nouveau promesse que je souhaite imaginer, composer, écrire, dessiner, toucher. Oui, je veux le toucher, je veux faire preuve de l’arrogance nécessaire pour me projeter dans ce futur non pas impossible et/ou dystopique mais utopique et/ou réellement réel.
Que faudra t-il imaginer? Que faudra t-il faire? Qu’est ce que cela exigera de nous? Je n’en sais foutrement rien. Enfin si, j’ai quelques hypothèses qu’il me faudra, avec l’aide de bonnes âmes allié•e•s urgemment déployer.
Je suis une page blanche sur laquelle vous pourrez écrire les scénarios lumineux de notre futur commun.
Mesdames, messieurs, la dystopie est annulée.
Demain, ce n’est plus loin.
Demain, c’est juste demain.