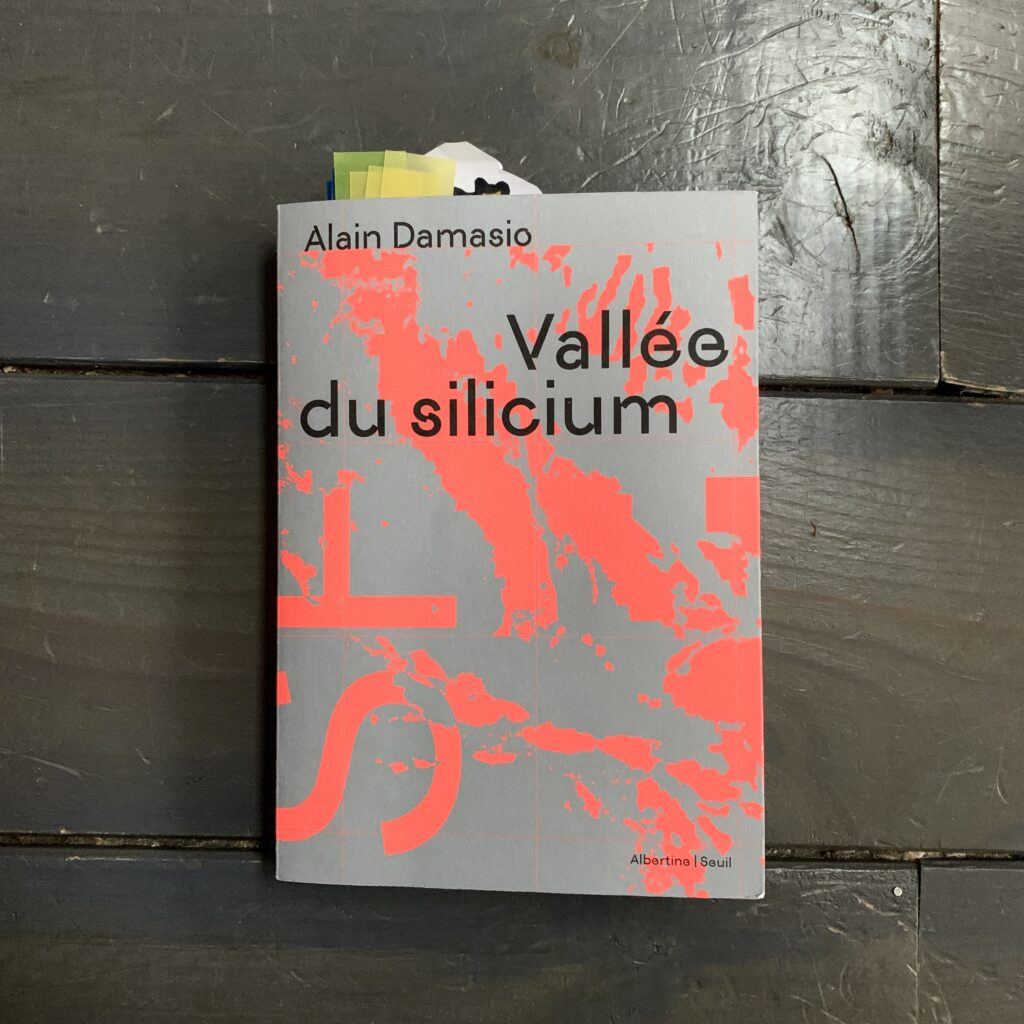« La matérialité du monde est une mélancolie désormais. »
Nous embarquons donc à ses côtés pour saisir le monde qui est le nôtre, érigé par les start-upeur•euse•s et informaticien•ne•s de sociétés états modelant l’hégémonie culturelle et les us et coutumes de vous et de moi, sapiens numericus branchés 24/24 sur le web et les réseaux sociaux. Le postulat initial de Damasio est limpide : si l’on souhaite comprendre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’il advient, il faut se coltiner ce lieu, ce way of life, cette religion : la Silicon Valley.
« En Amérique, l’original est la fiction. Le réel? Une copie. »
Nous voilà donc dans cette Ouest fantasmagorique, point d’orgue de la mythologie américaine, ce bout du monde américain où les hommes (l’historiographie mythologique, réflexe patriarcal oblige, a peu retenu les femmes) sont censés s’inventer et, par la même, inventer un monde nouveau. Et bien, on peut dire que cette fiction est bel et bien l’original. La Silicon Valley invente un monde, elle le rêve à grands coups de capital risque et d’investissements, souvent à perte, parfois gagnants, pour façonner un siècle où les énergies fossiles, les bagnoles et la maison individuelle sont supplantées (et non remplacées) par l’économie du virtuel et du numérique.
« La Silicon Valley nous offre un monde américain, quoi qu’on en pense. Rien d’universel en vérité. Elle répand une culture relationnelle qui ne part jamais du collectif, comme en Asie ou en Afrique, pour prendre des exemples sommaires, seulement de l’individu en tant qu’atome et centre de son monde, dont il va bien falloir, ensuite, penser les relations possibles avec les autres (le câblage). »
Petit détour par mon expérience personnelle. Je me suis socialisé à l’informatique sur le tard, n’étant pas adepte de jeux vidéos ou d’innovations informatiques dans mes enfance et adolescence. Mon éveil à l’internet s’est fait par le truchement d’un projet collectif de web-radio lancé en 2002. J’ai alors côtoyé des programmeurs, des nerds, certains cyber-punks dont Damasio annonce officiellement la mort, des romantiques du web, conscient de la puissance de cet outil et de ses potentialités émancipatrices. J’ai donc connu, un peu, cet âge d’or du web dit “libre“. Il ne l’était pas complètement. Ceci dit, ce temps, pas si lointain, constitue pourtant aujourd’hui une histoire lointaine, non pas la pré-histoire, mais l’histoire moderne du web. Son histoire contemporaine, la nôtre, est tout à fait autre, régie par une économie de la disponibilité et de la captation, qui n’a pas grand chose à voir avec les disséminations contre-hégémoniques qui constituaient la sève du web du début des années 2000. Le web était alors synonyme de collectivités, de communautés, de forums, d’interrelations. Ce n’était pas non plus un idéal communiste, entendons-nous là-dessus. Mais bon, pour mes comparses artistes-activistes, sans moyens ni réseau institutionnel, pour des tenants modestes de l’underground, le web représentait une promesse certaine et jubilatoire. Il me semble que le modèle propulsait par Zuckerberg, sociopathe comblant par l’outil algorithmiques ses infirmités sociales et relationnelles, a sonné la fin de la récréation collective. Tout le monde a créé son profil facebook et l’individu a repris ses droits. L’individu est roi en Amérique. Il l’est encore davantage partout aujourd’hui par les technologies numériques forgeant un quotidien où narcissisme et contemplation de soi sont récompensés, et payés en likes, comments et reposts.
« L’innovation dans le capitalisme consiste 95 fois sur 100 à décalquer dans tous les champs d’activité possibles une poussée anthropologique de fond : passer de la puissance au pouvoir. Autrement dit : de la capacité humaine à faire, directement et sans interface, avec ses seules facultés cérébrales, physiologiques et créatives, à la possibilité de faire faire, qui est une définition primaire du pouvoir. Faire faire à l’appli, au smartphone, aux algos, aux IA, aux robots… Comme on fait faire aux femmes, aux Arabes, aux esclaves, aux petites mains, aux sans-papiers sur leur vélo, ou tout bonnement à ses subordonnées hiérarchiques, ce qu’on ne veut pas condescendre à faire : ici se tient le pouvoir. »
Plus besoin de posséder pour s’enivrer de pouvoir. Dans un monde hyper-capitaliste régressif, où les inégalités contemporaines n’ont rien à envier à celles du XIXeme siècle, les technologies compensent notre précarité économique, la dislocation des relations sociales, le pourrissement du collectif par l’outillage numérique. On s’en fout de l’ascenseur social, le smartphone est notre plus grande richesse. Il nous permet de commander et de faire comme les grands de ce monde.
Avant de reprendre le fil de cette discussion solitaire, teinté de commentaires et références personnelles, je laisse Alain dérouler son propos.
« … personne n’avait imaginé l’impact anthropologique du smartphone, qui a été total. Le smartphone a tout simplement rebooté l’éthologie de Sapiens. Absolument rien de ce qui constitue nos modes d’être n’a été épargné : on ne travaille, ne joue, ne crée ou n’habite, on ne se déplace, ni n’échange, ne pense, ne danse ou ne baise comme on le faisait il y a encore trente ans. Tout a été intégralement révolutionné par un rectangle vitré de cinq centimètres par dix. Notre monolithe de 2001.
Sapiens reloaded est la saison 3 de l’anthropocène. »
« Mon hypothèse est la suivante. ce qui manque, selon moi, aux deux bouts du spectre, de la psychotique en chaise roulante jusqu’à Elon Musk, sociopathe d’extraction supérieure, en passant par les salariés d’une vingtaine d’années à 15000 dollars par mois, en passant par vous et moi, qui n’en faisons pas plus lourd, au mieux, que nous indigner en caressant distraitement la vitre de notre smartphone, ce qui manque, c’est le lien. La capacité à lier. L’empathie et la sympathie minimales. La faculté hautement humaine, mais aussi pleinement mammifère, à pouvoir souffrir et sentir avec. La faculté à pouvoir être traversé par cette détresse, à la recevoir plein corps, au point de ne plus pouvoir la tolérer sans agir.
Ce qui manque, c’est une aptitude, désormais largement perdue, laissée en jachère ou en friche par nos modes de vie numériques, à pouvoir nous confronter à l’altérité. A ce qui n’est pas nous, à ce que nous ne vivons pas, ne partageons pas directement.
Cette faculté de projection et d’identification, cette capacité d’écoute existentielle, d’accueil de ce qui souffre hors de nos bulles, cette faculté à sortir de soi, ou sans même sortir, à entrouvrir cette porte entre nos deux épaules pour laisser l’étranger ou la clocharde en franchir le seuil et entrer en nous, qu’ils viennent nous affecter, nous bouleverser et nous nourrir aussi, cette faculté est la première chose que le monde numérique a dégradée en étendant son empire et ses pratiques sur nos existences.
Sans doute touche t-on là au coeur de ma technocritique : la Tech, ontologiquement, conjure l’altérité. elle le repousse, la neutralise et la contrôle. Elle la métabolise pour en faire du même, elle réplique d’abord l’identique. Et quand l’altérité insiste, elle la fictionne. »
« On en le pointera jamais assez : les réseaux sociaux nous connectent, mais ils ne nous lient pas. Ils nous assemblent, certes, sans jamais obtenir de nous que nous soyons ensemble. »
conséquence…
« Tout fait symptôme du corps refoulé, tout fait retour : l’anorexie comme l’obésité, le jogging et le fitness, le yoga, la cuisine, le chemsex, les sports extrêmes, le business du bien-être, ou le bio… L’art contemporain hurle de l’appel au corps, de son rappel, de sa primauté. Le spectacle vivant en a fait sa rengaine, pas une performance qui ne prétende incarner, donner corps, se reconnecter à ses forces, jouer physique. Le cinéma et la littérature déplorent son absence ou son effacement, tentent de le rapatrier, le remettant en scène, au centre, au ventre, pour enjeu. On ne parle jamais autant d’une chose que lorsqu’elle disparaît. »
Damasio traduit par sa langue des constats et réalités éprouvés, à des degrés divers, par chacun•e d’entre nous. Nous éprouvons la perte, la petite ou grande mort de ce qui fonde, en partie l’expérience humaine : l’autre. Nous consentons et sommes compromis quotidiennement dans cette injonction contradictoire : être humain en se dépouillant de son humanité.
Pourtant, les horizons ne disparaissent jamais et il serait trop facile et certainement malhonnête de n’entrevoir qu’une dystopie du présent.
« Il y a des négociations incessantes avec l’outil, des appels et contre-appels, comme au foot, une forme de danse. Il y a du jeu : du jeu dans les interactions, dans les paramètres, dans ce qu’on zappe et clique, dans ce qu’on like et tape, dans ce qu’on impulse et dans ce qui revient. Et pour un programmeur qui forge ses propres bots, le jeu s’élève au carré > il confine à la liberté de création.
Au point que nous ne pouvons plus nous en tenir à l’ancienne hiérarchie fabricant/outil ou utilisateur/outil ; il faut plutôt parler d’une relation entre deux formes vivantes, au moins animées, d’une relation subtile entre l’humain et ses machines – subtile et plutôt horizontale. »
Pour parler de l’endroit que je maitrise le plus, la musique, la relation hommes-machines ou machines-hommes en constitue une histoire. L’histoire de la musique moderne, enregistrée, est une histoire de la technologie musicale et de la négociation opérée entre auteurs-autrices, musiciens musiciennes, producteurs productrices avec la technologie. Cette technologie s’incarne, si j’ose cet anthropomorphisme bancal, dans le studio : consoles de mixage multipistes, synthétiseurs analogiques, boites à rythmes, effets, informatique musical, plugins, VST. C’est ainsi que la pop music est aujourd’hui envahie par un algorithme de traitement vocal, l’auto-tune, censé originellement corriger les imperfections des voix, et devenus instrument et signature sonore des musiques mainstream de notre décennie.
Plus précisément, après ce très (trop) rapide résumé de l’intrication entre histoire musicale et avancées technologiques, la figure de producteurs techno de Detroit m’est venu en tête. Je me remémore ainsi la ligne de conduite, mi-artistique mi-philosophique mi-militante (ce qui fait trois “mi“ et donc “un et demi“) d’un Juan Atkins, expliquant son approche avec un instrumentarium issu de la technologie et de la production capitalistes, ces deux mêmes qui ont drainé tant d’ouvriers américains sur les chaines de montage des usines Ford et Général Motors. Il expliquait ainsi que son enjeu n’était pas de profiter simplement de cette technologie, de suivre la méthodologie afférente à leur utilisation, que ce soit une boite à rythmes ou un synthétiseur, mais de les pervertir, pour, finalement, les humaniser. Aller chercher au coeur de ses boitiers de métal, perclus de circuits électroniques une âme alien, emprunt de spiritualité, d’humanité. Tordre avec malice et douceur les machines pour entretenir avec elle une relation et leur donner le goût de la vie humaine.
« Pour Sapiens, l’espace fertile n’est ni l’intérieur, ni l’extérieur : il est cette lisière tremblée où l’on s’élève en se confrontant à ce qui n’est pas nous et que j’aime à appeler : l’altérieur. L’altérieur est la ligne de touche de la science-friction. Il est l’hétérotopie native, le lieu où, si l’on écrit de l’imaginaire, il faut aller porter ses personnages pour les mettre au monde ; le lieu où, si l’on prétend vivre une vie qui mérite d’être vécue, alors il s’agit d’oser bivouaquer. »
Damasio, outre Deleuze, Baudrillard, que j’ai évoqué et quelques autres figures intellectuelles fondatrices, rejoint ici Homi Bhabha. Son concept d’altérieur rejoint celui de l’interstice, de l’entre-deux, formalisé par le théoricien indien qui disait de la frontière, qu’elle est ce lieu où quelque chose ne finit pas mais commence à naître.
Une conclusion?
« si nous avons une responsabilité politique, elle est de battre le capitalisme sur le terrain du désir »
« En ce premier quart du XXIe siècle, assumer une position technocritique implique de mettre les mains dans ces quatre moteurs du désir pour en démonter les pièces : le fantasme de dépasser la condition humaine, la conjuration des peurs, la volonté de pouvoir et la paresse jouissive. »
Chiche?
« Résister consiste à ressusciter le désir »
Amen.