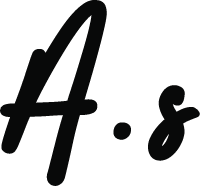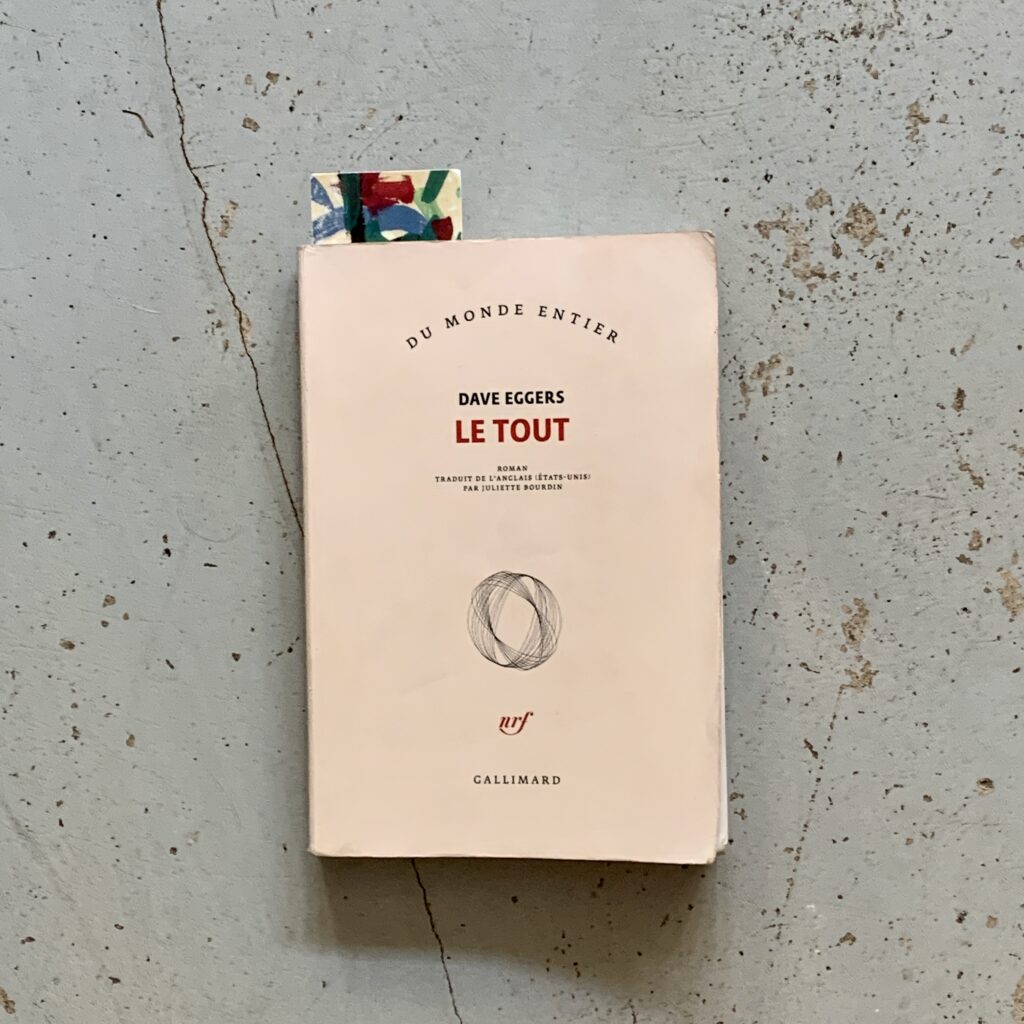ToutEcran
“Faire écran à“ désigne une attitude ou une action d’interposition. S’interposer entre.
L’écran, au sens figuré, constitue une force d’interposition, une médiation négative dans le sens où il ne s’agit pas de négocier une relation mais bien de l’empêcher.
Il est commun aujourd’hui de s’alarmer collectivement quant à la place des écrans. Pas un jour, ni une semaine sans un article, un livre, un podcast, une étude déplorant les effets délétères de l’ appareillage technologique contemporain sur le développement cognitif et comportemental des enfants et sur le régime relationnel induit par notre ère numérique. Je devrais certainement employer le terme ‘écran’ au singulier puisque j’évoque ici principalement l’écran de smartphone. Celui que nous brandissons parTout, à ToutMoment, en ToutLieu et TouteCirconstance. L’écran omniscient intégrant une structure d’applications organisant un nombre toujours plus conséquent de nos actions, de nos habitudes, de nos relations, de nos pensées.
Cette technocritique est donc banale. Si banale qu’elle peut même sembler dépassée et hors-sujet. Réflexe d’humanité mineure face aux nouveaux réflexes d’humanité gérés par le majeur, l’index et les pouces. Cette banale et convenue critique est à la base de “Le Tout“, roman de l’auteur et éditeur californien Dave Eggers. Sur plus de 600 pages, il déroule une fiction d’anticipation ultra-contemporaine, entretenant un flou déstabilisant entre ce qui semble relever du futur et ce qui constitue tout bonnement notre présent. Le Tout Monde de Glissant évacué et hacké par le ToutApplications de l’entreprise tentaculaire et monopolistique qui donne son nom au livre.
Un campus californien drainent des cerveaux bien faits et bien décidés à sauver le monde : freiner la catastrophe climatique, réduire l’insécurité, garantir la maitrise totale de sa vie, gouverner les relations et attitudes nuisibles au profit de relations et attitudes soi-disant vertueuses, transformer l’être humain en le dépouillant de son essence archaïque : l’imprévisibilité, le doute, le choix, le risque, la mort, l’autre, la subjectivité.
Jusque là, rien de neuf sous le soleil me direz-vous. C’est omettre le ton sarcastique et l’humour débordant de ce livre. C’est omettre également la performance littéraire de l’auteur bien décidé, à contre-courant d’une doxa post-moderniste noyant les responsabilités dans un océan de nuances où la seule complexité fait figure de condition explicative neutralisante, bien décidé donc à pointer du doigts des “coupables“. Je devrais plutôt employer le terme “responsables“, pour ne pas laisser croire que cette ouvrage fait figure de manifeste moral, ce qu’il n’est pas du tout, sans jeu de mots. M’enfin, face à l’intensité des responsabilités dont il est question, il me semble que le recours au champ de la culpabilité est plus juste. Ainsi, bien que les initiés technophiles et délirant de cette Silicon Valley réimaginée paraissent être les coupables idéaux, Dave Eggers, subtilement et de manière constante, pour ne pas dire redondante,, nous invite à changer de perspective pour entrevoir, non seulement le consentement de chacun•e (ou presque) à l’annihilation en règle de l’humain mais surtout, notre désir commun de cette protection, de cette agilité, de cette facilité, de ce confort même illusoire, que constitue l’écran numérique dans la conduite de nos existences personnelles et collectives.
Bouclier protecteur, manie et compulsion d’usage, addiction profonde. Delaney, le personnage principal du récit, souhaitant précipiter cette entreprise malfaisante et destructrice du haut de sa falaise technologique, n’a de cesse, une fois l’avoir incorporée tel un virus espion, de lancer des idées monstrueuses de contrôle et d’asservissement de ses contemporains. Rien n’y fait. Elle pense faire franchir le Rubicon, dans une tactique politique empreinte d’accélérationnisme, afin, elle l’imagine, de sidérer enfin les masses et fomenter la révolte. Le contraire se produit et le monde digère largement toutes les nouvelles applications proposées. Le monde ne semble désirer autre chose que d’être toujours plus enserré dans une camisole numérique.
Comment expliquer que tant de personnes critiquent à raison l’usage des réseaux sociaux sans toutefois quitter simplement ces mêmes réseaux? Il faut mener la bataille de l’intérieur, m’objecterez-vous. Au regard des évolutions récentes du techno-capitalisme, permettez moi de douter de cette stratégie.
Comment expliquer que la critique de l’uberisation, de la transformation profonde et à coup sûr sans retour, de l’économie vers le tout numérique, par laquelle les services tels que nous les connaissions se réduisent maintenant à de simples applications où algorithmes et IA font office de ressources humaines, ne débouchent sur autre chose que le consentement tacite à ces nouveaux usages? Nous sommes bien forcés de suivre le mouvement, tout en ayant conscience de ses méfaits, me répondrez-vous. Je ne fais pas beaucoup mieux que vous et ne vous accuse pas. Simplement, un fait est un fait. Même et encore plus à l’heure des faits dits alternatifs.
Comment donc expliquer ces injonctions contradictoires constamment à l’avantage de la structure numérique au détriment de la structure sociale autrement que par un désir partagé pour accomplir le saut d’un monde régi par des entités humaines vers celui gouverné par des machines?
Nous désirons être dépossédés de notre libre arbitre, de notre puissance d’agir, des efforts consubstantiels au développement intellectuel, cognitif et social.
Nous désirons faire écran aux rencontres fortuites, aux possibles désagréments des interactions sociales non consenties.
Nous désirons nous retrouver entre nous-mêmes, entre notre écran et nous.
L’altérité constitue aujourd’hui un archaïsme et son historicité connait une rupture majeure. Nous préférons la sécurité et le confort à l’imprévisibilité d’un monde en crise. C’est compréhensible et, dans une certaine mesure, c’est même légitime.
Le prix à payer reste conséquent.
Le déclin culturel de notre espèce.
Le rendez-vous manqué de la rencontre.
La fin de la relation comme elle s’est constituée anthropologiquement jusqu’au début du XXIeme siècle.
Le ToutEcran comme relation au monde.
J’avais promis de ne plus verser dans la dystopie. Je tiens mon engagement car amies, amis, ceci n’est pas le futur.
Ceci est bel et bien le présent.