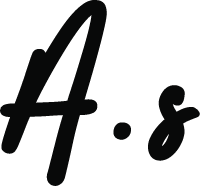Intérieur nuit
La techno est devenue un mot valise, employé par beaucoup et signifiant un ensemble de références, de signes et d’esthétiques sensiblement différentes suivant celles et ceux la considérant. Dans un pays, la France, où l’industrie musicale et la critique et presse spécialisée ont œuvré au crossover d’un mouvement né des marges socio-économiques, raciales et sexuelles vers les sommets des charts pop grâce à l’étendard French Touch (Radio France consacre cet été une énième série radiophonique à la célébration de ce succès planétaire de la house filtrée et de ses successeurs), les institutions culturelles et l’establishment qui les dirigent ont jugé bon de visibiliser dernièrement la sous-culture musicale électronique.
Comme le synthétise très bien Joseph Confavreux dans un article de Médiapart, le dispositif, pour ne pas dire l’espace social dans lequel sont nées et se sont développées les cultures dance électroniques font l’objet d’une attention prononcée du monde intellectuel, culturel et médiatique, par le truchement d’expositions d’envergure, telles que “Disco. I’m coming out“ présentée à la Philharmonie de Paris ou “Clubbing“ au Grand Palais Immersif et d’un renouvellement éditorial dans la manière d’envisager et de considérer les sous-culture de la fête, avec notamment les travaux d’Arnaud Idelon – Boom Boom. Politiques du dancefloor (Editions Divergences) – qui a multiplié ces derniers mois les interventions médiatiques, les publications d’Audimat Editions gérées par Guillaume Heuguet, ou le récent ouvrage collectif Techno & co, Chroniques de la culture dance électronique (Editions Amsterdam) dirigé par Vincent Chanson.
On raconte donc les histoires et le présent de mouvements musicaux encore largement minorisés, tels que la rave, la jungle, l’idm ou l’ensemble des sous-genres de la techno, dont la variable géographique est indispensable à considérer pour saisir la cartographie du même changeant (Paul Gilroy) qu’elle constitue, historiquement à Chicago, Detroit, New-York, Berlin ou Paris et aujourd’hui sur l’ensemble de la planète. On se préoccupe également des imaginaires sociaux et politiques que ces cultures charrient et véhiculent, ainsi que des forces évocatrices et émancipatrices immanentes à leur développement, en particulier au sein des minorités de genre et des minorités racisées.
On s’en préoccupe peut-être aussi comme d’autres se préoccupent d’écologie et d’extinction du vivant, ou du corps et de la relation que l’on entretient avec lui/eux, l’ensemble de ces préoccupations constituant à n’en point douter des zones à défendre à l’heure de la catastrophe présente et à venir. On célèbre la fête au moment où elle nous échappe et se meurt, bouffée comme l’ensemble du corps social par les métastases du réalisme capitaliste.
Je suis un lecteur assidu d’Audimat Editions, depuis le lancement de leur revue du même nom, jusqu’aux travaux de théorie critique et traductions d’ouvrages qu’ils proposent. J’ai lu le brillant ouvrage d’Arnaud Idelon ainsi que le non moins brillant livre collectif dirigé par Vincent Chanson. Je peux même dire qu’enfin, je perçois à travers les lignes de leur texte, les problématiques qu’ils formulent et les développements analytiques et critiques qu’ils énoncent les allié•e•s tant attendus. Comme il fut toujours le cas en matière de production et de diffusion musicales, je peux dire qu’ils comblent le fossé entre la vivacité de la production intellectuelle anglaise des cultural studies, depuis leur formalisation par Stuart Hall et le Centre of Contemporary Cultural Studies de l’Université de Birmingham établi en 1964 jusqu’au Cybernetic Culture Research Unit rassemblant à l’Université de Warwick dans les années 1990 les continuateurs de cette école de pensée, tels que Simon Reynolds, Mark Fisher ou Kodwo Eshun, et le vide français sur ce champ de recherche, croisant théorie critique, analyse sociale et politique par le prisme des rapports de force culturels, critique musicale et anticipation science-fictionnelle. Un champ lexical et une logique de pensée des cultures populaires forment ainsi un commun entre ces travaux, au premier titre desquels la notion de continuum hardcore popularisée par Simon Reynolds.
Signe des années 1990 avec l’émergence ou le développement d’innovations sonore et musicales telles que la jungle, l’ambient, le breakcore, la techno hardcore, la rave, le UK Garage, l’ensemble des ces observateurs bercés aux travaux de Reynolds et Fisher attestent de la rupture de la première décennie 2000 où cette effervescence underground et sauvage de sons du futur semble s’essouffler, s’enrayer pour ne devenir aujourd’hui que le pastiche d’un âge d’or plus ou moins fantasmé. En attestent les innombrables playlists de jeunes djs de musiques électroniques digérant jusqu’à l’overdose les musiques hardcore d’hier, devenues aujourd’hui les sons mainstream des festivals techno où se produisent des djs sur scène devant une foule de milliers de spectateur•ice•s. Il me faudrait apporter nombre de nuances et de subtilités à cette analyse à la serpe des scènes électroniques contemporaines, regorgeant également d’artistes et de musiques tout à fait excitantes. Il n’en reste que le futur est perdu, le futur ne représente plus aucune promesse et cela se ressent, globalement, dans la production musicale dite underground. Ainsi Simon Reynolds popularisa également le terme de retromania, ou cette tendance à voir le passé comme un avenir indépassable.
Il n’en reste que l’attention est particulièrement portée sur les musiques électroniques et leur appétence féroce et hardcore. Il n’est pas question de broken beat, de cosmic house, assez peu de 2-Step ou de deep house. Le soulful n’a pas lieu d’être dans un monde promis à la démolition, nous dit-on.
Né en tant que dj au cœur du réacteur du continuum hardcore de la fin des années 1990, les free parties, puis embrassant le mouvement jungle/drum’n bass pendant de nombreuses années, je ne peux réfuter le constat que l’avenir s’écrivait bien pour moi aussi par le clair obscur des basses fréquences et les rythmes frénétiques de la techno hardcore. Pourtant, il y a une vingtaine d’années maintenant, j’ai délaissé le continuum hardcore pour prêcher l’amour. J’ai découvert la disco, la house, je me suis constitué une solide culture musicale afro-américaine, j’ai voyagé sur différents continents par la musique pour rechercher la lumière à travers elle. Des rythmes miraculeux, des mélodies merveilleuses et des musiques qui se vivent avec le corps et l’esprit, soit la lettre de mission de mon émission radiophonique Open Sky, démarrée il y a plus de 10 ans.
Aujourd’hui, je me sens rattrapé par le continuum hardcore. Comment prêcher (seulement) l’amour, le désir, la communion en musiques quand le monde brûle et que le délire morbide et mortifère gagne les pays et les continents. Comment être sincère, authentique et généreux dans ce don que constitue un set musical dont le fil narratif sont l’espoir et la lumière quand le monde n’est que dégénérescence, abandon et folie meurtrière ?
“Désespérer, c’est trahir. Trahir ceux qui ont vécu et sont morts en rêvant encore d’espoir“ dit le poète Elia Abu Madi.
Recouvrir l’univers des forces hardcore n’est pas un aveu d’échec, ni un signe d’abandon et de désespoir. C’est simplement une réponse possible aux forces malfaisantes et inattaquables qui nous assaillent.
Recouvrir mon devenir hardcore, c’est respecter l’adolescent et le jeune adulte que je fus, le régénérer par la trajectoire de vie que j’ai suivie depuis et qui me permet de manier d’avantage de munitions sonores qu’auparavant.
Recouvrir le continuum hardcore, c’est me préserver un espace pour continuer sereinement à prêcher l’amour au grand jour.
Ainsi Intérieur Nuit fait jour dans une obscurité quasi totale.